1.2. L'humidité
 L'humidité | L 'humidité relative de l'air (HR) est le facteur le plus important pour la conservation des documents d'archives, car elle joue un rôle décisif dans la plupart des processus de dégradation. L’air ambiant n' est généralement pas totalement sec: il absorbe une certaine quantité de vapeur d'eau qui varie fortement en fonction de sa température. Quelques concepts et définitions sont indispensables pour aborder la climatologie. |
1.2.1. L'humidité absolue
L'humidité absolue est la quantité réelle de vapeur d'eau présente dans une masse d'air.
Elle ne varie pas avec la température.
Elle peut être mesurée en grammes par m3 d' air sec ou en grammes par kg d'air sec.
1.2.2. L'humidité saturante
L'eau s'évapore dans l'atmosphère jusqu'à ce que soit atteinte une proportion maximale de vapeur d'eau dans l'air. C'est ce qu'on appelle l'humidité saturante qui correspond à la capacité maximale d'absorbtion de la vapeur d'eau dans une masse d'air à une température donnée. L'humidité saturante varie donc avec la température.
Le graphique suivant montre, pour une température donnée, la quantité maximale de vapeur d'eau exprimée en grammes par kg d'air sec pouvant être absorbée à différentes températures.
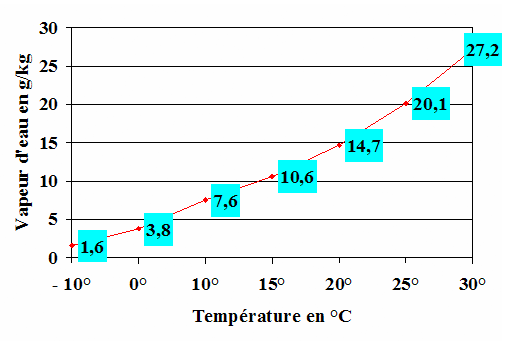
On peut faire les deux constatations suivantes :
Plus l'air est chaud, plus sa capacité à retenir la vapeur d'eau est grande : à 20° C, 1 kg d'air sec peut absorber jusqu'à 14,7 grammes de vapeur d'eau.
A l'inverse, plus l'air se refroidit, plus sa capacité à retenir l'eau diminue : à 10° C, 1 kg d'air sec ne peut plus absorber que 7,6 grammes de vapeur d'eau.
1.2.3. Qu'est-ce que l'humidité relative ?
Il faut avoir parfaitement compris les notions d'humidité absolue et d'humidité saturante avant d'aborder celle de l'humidité relative :
Définition : L'humidité absolue et l'humidité saturante
L'humidité absolue est une donnée factuelle, le constat d'une réalité objective, indépendamment de tout facteur.
L'humidité saturante est une donnée physique, intangible et déterminée par les lois naturelles.
L'humidité relative rend compte du rapport entre ces deux données : la quantité effective de vapeur d'eau contenue dans un volume d'air donné (l'humidité absolue) et la quantité maximale que ce même volume peut contenir à une température donnée (humidité saturante).
L'humidité relative se traduit par un pourcentage :
humidité absolue x 100 / humidité saturante
C'est aussi ce qu'on appelle le taux d'hygrométrie.
Exemple :
Nous sommes dans une pièce où il fait 20°C. L'air de cette pièce contient 7,35g par kg d'air sec (humidité absolue).
A 20°C, on sait que l'air peut absorber au maximum 14,7g de vapeur d'eau par kg d'air sec (humidité saturante, selon diagramme[1]).
L'humidité relative se calcule ainsi : | Calcul de l'humidité relative |
Nous avons une humidité relative de 50%.
L'humidité relative est de : | Autre calcul |
Plus l'humidité relative est grande, plus l'air est humide.
1.2.4. Le point de rosée
Nous savons qu'à 10°C l'humidité saturante est à 7,6g par kg d'air sec (diagramme). Imaginons qu'en ouvrant une porte nous fassions entrer de l'air humide, tout en maintenant la température à 10°.
Si l'air atteint EFFECTIVEMENT 7,6g de vapeur d'eau par kg d'air sec (humidité absolue), il a atteint sa capacité maximale d'absorption : on dit que l'air est saturé.
L'humidité relative se calcule ainsi : | Calcul de l'humidité relative |
On a 100% d'humidité relative. C'est ce qu'on appelle le point de rosée.
Inversement on pourra dire aussi que lorsque l'on a une humidité absolue de 7,6g par kg d'air sec, la température de rosée est à 10°.
Lorsque l'on atteint 100% d'humidité relative, la moindre chute de température provoque la condensation de la vapeur et l'apparition de minuscules gouttes d'eau. Il s'agit du phénomène de rosée.
Complément : Quelques effets du phénomène de rosée
Le phénomène de rosée ou de condensation peut produire différents effets :
Par exemple :
Si nous reprenons l'exemple de notre pièce, refroidissons-la jusqu'à 8° C sans assécher l'air. Celui-ci contient toujours 7,6g de vapeur d'eau par kg d'air sec (humidité absolue). On sait qu'à cette température, il ne peut absorber que 6,7g de vapeur d'eau par kg d'air sec (humidité saturante).
L'humidité relative est de : | Calcul humidité relative |
Dès que l'humidité relative dépasse 100% se produit un phénomène de condensation : la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air est supérieur à celle qu'il peut absorber et il y a formation de brouillard.
Voyons maintenant ce qui ce qui se passe lorsque nous entrons dans notre voiture garée en plein air un matin d'hiver. Au début, l'air est froid à l'extérieur et à l'intérieur de la voiture. Notre entrée et la mise en route du chauffage provoquent un réchauffement de l'air, ainsi qu'une légère augmentation de l'humidité absolue à cause de notre respiration. Les vitres restent froides : à leur contact la vapeur d'eau contenue dans l'air à l'état gazeux à l'intérieur de la voiture se condense en fines gouttelettes qui forment une buée sur la vitre.
Pour lutter contre ce phénomène, nous avons à notre disposition plusieurs moyens :
Essuyer la vitre avec un chiffon pour enlever la buée, mais celle-ci se reforme presque instantanément, car les conditions climatiques n'ont pas changé.
Ouvrir une fenêtre de la voiture : cela provoque une chute de température et rétablit un certain équilibre entre la température de l'air ambiant et celle des vitres, qui ne jouent plus leur rôle de point de condensation.
Chauffer le pare-brise en déclenchant le système de désembuage, afin qu'il ne soit plus un point de condensation.
Prenons enfin l'exemple d'un registre conservé dans de bonnes conditions dans un magasin à 18°C et 50% d'humidité relative. Sortons-le brusquement à l'extérieur dans un air ambiant à 30°C et 80% d'humidité relative, situation très fréquente en pays tropicaux et équatoriaux, conditions auxquelles la température de rosée est à 26°. Le document étant plus froid, il va se former immédiatement à sa surface une buée. D'où l'importance d'éviter ce genre de situation et de mettre dans des conditionnements étanches et bien isolants les documents lorsque l'on est obligé de les sortir dans de telles conditions climatiques.
1.2.5. L'utilisation du diagramme de Mollier
Le diagramme de Mollier met en relation température, humidité absolue et humidité relative : il permet de comprendre les interactions entre ces trois données et d'en faire une analyse exacte.
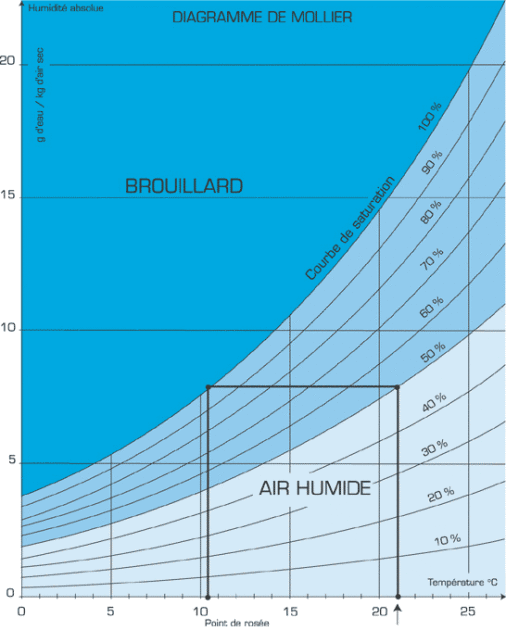
Nous allons apprendre à nous servir du diagramme de Mollier au moyen de quelques exemples simples.
diagramme de Mollier
Exemple : Premier exemple
Dans une pièce, il fait 20° C. L'air de cette pièce contient 7,35 g. de vapeur d'eau par /kg d'air sec (humidité absolue).
A 20° C, on sait que l'air peut absorber 14,7 g. de vapeur d'eau par kg d'air sec (humidité saturante).
Si dans une pièce, nous avons pu mesurer que nous avons 21° C et 50% d'humidité relative, cherchons la température de rosée, c'est-à-dire la température à laquelle nous devons descendre pour obtenir 100% d'humidité relative et en dessous de laquelle il y aura condensation.
Nous pouvons aussi connaître l'humidité absolue, c'est-à-dire la quantité réelle de vapeur d'eau présente dans la pièce. Le diagramme de Mollier est particulièrement utile pour connaître cette donnée, car généralement elle ne fait pas l'objet de mesures : les appareils indiquent la température et l'humidité relative, pas l'humidité absolue. La connaissance de cette donnée peut être importante pour déterminer s'il faut assécher l'air, ou au contraire, l'humidifier.
Connaître les phénomènes climatiques permet de comprendre les problèmes qui peuvent se poser dans un magasin d'archives :
Exemple :
Nous avons pu déterminer par des mesures que dans notre magasin d'archives, nous avons une température de 18° et un taux d'hygrométrie de 50%, a priori donc les conditions climatiques idéales pour la conservation des papiers. D'après le diagramme de Mollier, cela correspond à une humidité absolue de 9g/kg. Mais les appareils de mesure ont été placés au centre du magasin, dans un endroit bien protégé des influences extérieures éventuelles. Si, en plein hiver, nous effectuons des mesures tout près d'une fenêtre, il se peut que nous ayons seulement une température de 15°. Il y a de fortes chances que l'humidité absolue soit identique à celle qui règne dans le reste du magasin, soit 7g/kg. Or à 15°, l'humidité saturante est de 10,6g/kg. Nous aurons alors dans cet endroit précis une humidité relative de

, soit presque 66%. C'est ce qu'on appelle une poche d'humidité.
Le même phénomène peut se produire près d'un mur extérieur mal isolé et exposé au nord, ou près de la porte d'entrée du magasin, par exemple.
L'utilisation du diagramme peut aussi permettre d'interpréter correctement les données fournies par les appareils de mesure et d'éviter des décisions mal fondées.
Exemple :
Dans une pièce fermée, on a pu mesurer une température de 17°C et un taux d'hygrométrie de 80%. A l'extérieur, il fait 25°C et l'on a un taux d'hygrométrie de 60%. On pourrait penser qu'il fait plus sec à l'extérieur et décider de faire entrer de l'air dans la pièce, tout en maintenant la température à 17°C. Reportons-nous au diagramme de Mollier : nous constatons que dans la pièce, nous avons une humidité absolue de 10g/kg d'air sec, alors que dehors nous atteignons 12g/kg d'air sec. Contre toute apparence, l'air est donc plus humide à l'extérieur qu'à l'intérieur. Si nous faisons entrer de l'air, nous allons rendre la pièce plus humide et nous risquons même d'atteindre le point de rosée.
1.2.6. L'influence de l'humidité relative sur la conservation
Pour une bonne conservation des documents d'archives traditionnels sur papier et parchemin, on considère que l'humidité relative doit être maintenue de manière constante à un taux de 50 % avec une variation acceptable de 5 % en plus ou en moins.
Les dégâts causés par une mauvaise régulation de l'humidité relative peuvent être multiples.
1.2.6.1. Les dégâts
Une sécheresse excessive (HR inférieure à 40%) provoque l'évaporation des molécules d'eau liés par des ponts hydrogènes qui se trouvent dans les fibres des matériaux, notamment le papier qui perd alors sa souplesse et se fragilise.
Mais c'est surtout l'excès d'humidité qu'il faut craindre. Au dessus de 60 à 65% d'humidité relative, les dégâts peuvent être les suivants :
une accélération très importante des réactions chimiques d'altération;
la germination des spores des micro-organismes et la création de conditions favorables au développement et à la survie de nombreux insectes (liens avec les parties suivantes);
la migration d'éléments nuisibles toujours plus en profondeur dans l'objet : produits issus des réactions d'altération du papier, ions métalliques provenant des encres et des pigments, de polluants atmosphériques, etc. qui étendent ainsi la zone altérée;
la déformation par gonflement, en particulier dans les objets composites tels que les reliures, surtout si l'humidité augmente rapidement.
1.2.6.2. Le cas des documents composites
Il convient de considérer que de nombreux documents sont composites et peuvent comporter, outre le papier ou le parchemin, des matériaux aux caractéristiques physiques et chimiques très différentes :
cuirs, métaux et bois des reliures
colles
encres
cire des sceaux et cachets
matières textiles (reliures, échantillons de tissus, éléments de scellement, etc.)
Dans tous les cas, la qualité principale qui nous intéresse ici leur capacité à absorber ou à désorber l'eau sans dommage matériel important. Toute variation de l'humidité provoque des phénomènes mécaniques :
une augmentation de l'humidité provoque une dilatation des matériaux
une diminution de l'humidité provoque au contraire une contraction
Les possibilités de dilatation ou de contraction n'étant pas identiques pour tous les matériaux, autant en ampleur qu'en rapidité, ces phénomènes peuvent engendrer des déformations dans le cas de documents composites, reliés avec du cuir ou du parchemin par exemple.
C'est pourquoi aussi les variations brusques de la température et de l'humidité relative sont particulièrement préjudiciables aux documents.






