Lettre n°3

 Editorial de Didier Grange,
Editorial de Didier Grange,
Président du comité directeur du PIAF
Genève le 20 mai 2010 : le PIAF en phase de consolidation
Depuis quelques mois le PIAF est en pleine mue. Les modules de formation font l’objet d’une révision systématique. Certains d’entre eux sont remplacés ; d’autres, inédits, apparaissent pour la première fois ; quant aux derniers, ils sont partiellement repris, modifiés et complétés. Il s’agit là d’un exercice délicat mais nécessaire. Le moment est venu de faire évoluer le contenu du PIAF. Rien que de plus normal : le temps a fait son œuvre. Quant à la technologie employée pour mettre à disposition le PIAF, elle a aussi été revisitée. Résultat, nous avons décidé de passer à une nouvelle génération de technologie(s). Ces changements ne sont pas cosmétiques mais profonds. Ils demandent un travail considérable de reconstruction, de remodelage, d’adaptation et d’ajustement. Un grand merci à toutes les personnes qui ne comptent pas leur temps et mettent leur énergie et leurs compétences à disposition pour faire que le PIAF 2.0 soit -déjà- une réalité.
Faire peau neuve comporte toujours des risques. Il va falloir bien négocier le virage pour ne pas sortir du chemin que nous avons tracé… Notre objectif est d’offrir une nouvelle version du PIAF qui soit revue de fond en comble et qui fonctionne de manière satisfaisante. Or, les obstacles sont nombreux. Nous le constatons depuis quelques temps. Nous apprenons aussi. Même si bien des travaux ont déjà été réalisés, la consolidation demandera encore quelques mois. Patience. La précipitation n’est pas une option à mon sens dans un tel projet. Dès lors, il est important que les visiteurs/utilisateurs du PIAF soient conscients du virage dans lequel se trouve actuellement le PIAF. Il faudra qu’ils reviennent régulièrement visiter le site pour observer les évolutions qui vont se succéder et les résultats des efforts consentis par toutes les personnes et institutions impliquées.
Parmi les activités que nous avons menées récemment autour du PIAF, relevons l’extraordinaire semaine vécue à Dakar, au mois d’octobre 2009. Plus de 130 archivistes provenant de 26 pays ont profité de la générosité et de l’hospitalité de nos collègues des Archives nationales du Sénégal et de l’EBAD, avec l’appui de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et du Conseil International des Archives (ICA), pour se familiariser avec le PIAF et l’enseignement à distance. Au-delà de la formation, ce sont des liens que nous espérons solides et durables qui se sont tissés entre les participants à cette première Semaine Internationale des Archives Francophone (SIAF). Aller à la rencontre de ses utilisateurs, les écouter, échanger avec eux, a été une expérience fantastique pour toutes les personnes du PIAF présentes à Dakar. Il conviendra désormais de construire le futur du PIAF en se reposant aussi sur ces réseaux de professionnels et d’étudiants. Nous avons pu constater lors de cette semaine combien le PIAF répond à un besoin et combien, dans différents contextes, le PIAF peut constituer une réponse adéquate aux besoins. Notons également au passage, l’étroite collaboration mise en place avec le Conseil International des Archives (ICA), qui a soutenu la réalisation de cette semaine et qui a organisé à cette occasion différents ateliers de formation, suivis par bon nombre de participants. On peut se demander dans quelle mesure ce type de semaine et de partenariat ne pourrait pas être renouvelé dans d’autres pays francophones. A suivre…
Le Comité directeur du PIAF s’est réuni au mois de janvier à Bruxelles pour faire le point. Il a bien sûr évoqué les modifications en cours et listé les différents travaux qui doivent encore être accomplis dans cette phase de consolidation. Mais il a aussi consacré du temps à définir quels pourraient être les projets dans lesquels l’équipe pourrait se lancer dans les mois qui viennent. Nous reviendrons dans quelques temps sur les idées qui ont émergé.
Pour finir, un mot de gratitude envers deux personnes qui ont porté le PIAF pendant de longues années et qui en ont fait ce qu’il est aujourd’hui : à la fois un magnifique projet collaboratif francophone et un instrument de formation et de travail performant. Je veux parler bien sûr de Gérard Ermisse qui a été l’origine du PIAF avec un petit groupe d’archivistes francophones et de Marie-Edith Brejon de Lavergnée, coordinatrice du volet « Se former », véritable cheville ouvrière de la réalisation des différents modules de formation offerts en ligne. Même si petit à petit ils prennent de la distance, ils continueront à nous épauler et à suivre l’évolution du PIAF, j’en suis convaincu.
Comme nouveau Président du Comité directeur, c’est aussi pour moi l’occasion de remercier tous les auteurs, techniciens, webmestre, membres du Comité directeur et institutions qui participent à cette belle aventure, la soutiennent, la font évoluer et lui permettent de vivre.
Rendez-vous est pris avec vous pour de nouvelles informations, dans quelques temps…
Dernières nouvelles du PIAF…
La SIAF de Dakar (semaine internationale des archives francophones)
La première semaine internationale des archives s’est déroulée à Dakar, Sénégal, du 19 au 24 octobre 2009. Elle a regroupé 130 participants venus de 26 pays d’Afrique ainsi que de l’Europe et de l’Amérique du Nord.
Organisée par le comité directeur du PIAF, l'ICA en étroite collaboration avec les autorités du Sénégal et en particulier les Archives nationales du Sénégal et l’EBAD, cette semaine semble avoir atteint les objectifs qui avaient été établis : former des apprenants à l’utilisation des formidables outils que représentent le PIAF, le logiciel AToM at la Boute à outil de l'ICA ; renforcer les liens entre les archivistes (ou futurs archivistes) francophones ; promouvoir les archives francophones.
La couverture médiatique dont l’événement a été l’objet et la présence du Premier ministre du Sénégal en sont les preuves.
« Cette semaine a été une occasion unique de diffuser, encore plus que ce n’est le cas, le Portail International Archivistique Francophone auprès des archivistes et de tous ceux que les Archives intéressent dans la région de l’Afrique de l’Ouest et de tenir un séminaire de formation de formateurs . Elle a pu permettre de réunir tous leurs correspondants et relais dans les pays francophones, ainsi que les étudiants en archivistique de l’EBAD. Nous tenons aussi à souligner que cette rencontre de Dakar a été une occasion de donner un coup de projecteur sur les Archives dans les sociétés africaines et au Sénégal en particulier. » (Jean Bosco Ntungiramana, Vice-Président de l’Association des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes du Burundi). Vous trouverez des compte-rendus plus détaillés dans les archives des actualités sur le PIAF.
Le passage au web 2.0
Une fois encore, le PIAF a fait peau neuve pour tirer parti des derniers progrès technologiques et répondre au mieux aux besoins de ses internautes.
Le portail est aujourd’hui composé de différentes applications qui répondent aux exigences des différentes rubriques. La plateforme pédagogique est gérée par l’outil Mahara, la plateforme de cours par Moodle, avec lequel les universitaires sont familiers. Le logiciel de gestion Drupal remplace CPS qui ne permettait pas de mettre en place les fonctions participatives.
Jusqu’à présent le PIAF était un site relativement statique qui offrait aux internautes de précieuses informations mais les procédures de contribution restaient assez lourdes et complexes. Le web 2.0 favorise l’interaction des utilisateurs ce qui nous a paru essentiel à l’enrichissement de notre site et à l’animation de notre communauté archivistique francophone. Le PIAF 2.0 offre des capacités de stockage, de diffusion et de création bien supérieurs au PIAF 1.0.
En ce sens le projet PIAF tel qu’il est défini aujourd’hui s’apparente à un projet de « sciences citoyennes ». Très en vogue depuis les années 2000 dans le monde anglo-saxon, ce concept reste relativement peu développé dans le monde francophone. Les avancées informatiques et l’apparition d’outils de travail collaboratif très performants ont encouragé la création de groupes de travail composés de spécialistes et de néophytes ou amateurs autour d’un projet de réflexion. Les premiers projets de sciences citoyennes se sont développés dans le domaine de l’écologie ; cette pratique s’étend depuis à des domaines extrêmement divers. Pourquoi pas à l’archivistique francophone ?
Qu'apporte le PIAF ?
Lors de la SIAF 1 à Dakar, nous avons soumis à 36 apprenants un questionnaire visant à mieux les connaître d’une part et à évaluer les besoins et les améliorations à réaliser sur le PIAF d’autre part.
Le public était donc composé d’apprenants avertis (archivistes, étudiants ou enseignants en archivistique).
Tous les apprenants ont souligné la qualité des contenus du PIAF et l’importance de cette formation à distance dans des pays où la formation continue n’est pas forcément proposée.
68,5% des sondés estiment qu’il existe une formation continue dans leur pays mais elle est réservée à une petite minorité puisque 62% ne disposent pas des moyens pour en bénéficier. D’où l’importance de la mise à disposition d’une formation en ligne gratuite (97,2% des sondés estiment que l’E-formation est utile et 100% que la formation dispensée par le PIAF est utile). L’activité du PIAF est reconnue utile à l’unanimité mais elle reste encore trop modeste notamment dans le domaine de la formation universitaire. Si 74,2% des sondés estiment que l’activité du PIAF a un impact sur les services d’archives de leur pays, seulement 44% des sondés estiment que le PIAF sert de support de cours dans les universités de leur pays. Il nous faut donc continuer nos efforts de promotion du Portail. Nous fondons beaucoup d’espoir sur le potentiel participatif qu’offre le passage du PIAF au web 2.0 ; la possibilité d’ouvrir des espaces de travail collaboratif dans le volet E-pédagogie nous paraît également bien répondre au souci que nous avons de tisser des liens avec les universitaires.
Tous (100%) pensent que le PIAF peut aider les archivistes à améliorer leur niveau professionnel et qu’il est une ressource utile pour les enseignants comme pour les étudiants.
Axes et chantiers du PIAF en 2010.
La réunion bisannuelle du comité directeur du PIAF s’est tenue aux Archives Générales du Royaume à Bruxelles, à la mi-janvier 2010. Nous avons été royalement reçus par nos collègues belges et avons mis à profit ces deux jours pour établir le programme des travaux à entreprendre cette année et des améliorations à réaliser sur le PIAF. Deux membres pionniers et éminents nous quittent : Madame Marie Edith Brejon de Lavergnée, responsable du volet « se former » et Monsieur Gérard Ermisse, Président du comité directeur du PIAF. La transition mise en place depuis plusieurs mois déjà se poursuit en douceur mais n’ôte rien à notre tristesse de voir deux de nos membres si éminents et si sympathiques nous quitter !
Vous trouverez sur la page d’accueil du PIAF le calendrier de révision des modules de cours prévues pour 2010. L’espace professionnel de travail collaboratif est enfin en place, quelques groupes se sont crées dont un autour d’une réflexion sur les bâtiments d’archives. Vous recevrez un courrier détaillé sur son fonctionnement et les possibilités ainsi offertes. Autre nouveauté : la bibliographie ! Après plusieurs années de travail effectuées à Québec, quelques milliers de notices sont maintenant en ligne ; vous y trouverez les incontournables de la science archivistique francophone !
Regard vers une institution membre de l’AIAF…

En préconisant dès 1963, la création d’un Centre Régional de Formation de Bibliothécaires (CRFB) les présidents Léopold Sedar Senghor du Sénégal et Amani Diori du Niger exprimaient deux convictions fortes : promouvoir des cadres africains pour remplacer les personnels des expatriés qui avaient la charge de gérer les services d’archives et les bibliothèques laissés en jachère par l’administration coloniale d’une part, marquer la présence de l’Afrique dans le concert des opérateurs de la francophonie d’autre part. Depuis 1963, beaucoup d’eaux auront coulé sous les ponts ; outre l’intégration en 1968 du CRFB à l’Université de Dakar, un autre évènement majeur mérite d’être pointé dans ce rapide survol de 46 années d’existence de l’EBAD. Il s’agit du lancement en 2001, de la première expérience d’enseignement à distance en Afrique au Sud du Sahara. A la suite d’un appui substantiel de la coopération française et grâce à l’accompagnement décisif de l’Agence Universitaire de la Francophonie, cet institut spécialisé dans la formation aux métiers des archives, de la bibliothèque et de la documentation a su adapter ses contenus d’enseignement et ses stratégies pédagogiques aux nouvelles orientations induites par l’irruption des TIC et de l’internet dans les dispositifs d’enseignement et de recherche.
L’aventure a commencé par la mise en ligne des cours du second cycle (2001 à 2004) et s’est poursuivie avec l’adoption de la reforme LMD qui a été l’occasion d’un autre ajustement des stratégies de formation. Désormais notre offre de formation en ligne est ordonnée autour de plusieurs classes virtuelles :
• une classe virtuelle Afrique occidentale polarisant autour de l’EBAD comme point focal, les apprenants de la sous région (Bénin, Burkina, Cap Vert, Cote d’Ivoire, Gambie, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Togo) une classe virtuelle Afrique centrale polarisée par l’ESSTIC et réunissant les apprenants du Burundi, du Cameroun, de Centrafrique du Gabon, du Rwanda, du Tchad, de Centrafrique
•.une classe océan indien basée Antananarivo puis à Maurice et fréquentée par des apprenants malgaches au cours des deux années de fonctionnement de cette classe
• une classe Maghreb qui reçoit les apprenants du Maroc et d’Algérie
Lorsqu’ils ne sont pas dans ce dispositif, les apprenants travaillent en toute autonomie et profitent du réseau de l’auf qui offre à travers ses campus numériques, d’excellentes conditions pour l’apprentissage à distance.
Invités à se connecter sur la « plate forme maison » installée sur le site de l’EBAD (www.ebad.ucad.sn) les apprenants récupèrent les cours mis en ligne, subissent les évaluations en temps réels, effectuent un stage virtuel à distance, sont assistés par des tuteurs locaux et préparent leurs projets professionnels sous la supervision d’enseignants de l’EBAD qui sont relayés par des professionnels ayant une compétence avérée et reconnue. La restitution de ces travaux exige souvent le déplacement de l’étudiant vers la capitale zonale, Dakar pour l’Afrique occidentale, Yaoundé, Kigali ou Bujumbura pour l’Afrique centrale et Antananarivo pour la grande île. Pour réduire les coûts inhérents à l’organisation des soutenances, la stratégie pédagogique utilise régulièrement la visioconférence. Elle intervient aussi dans le programme des stages de regroupement et permet aux apprenants d’une même classe de démarrer l’année dans les conditions les meilleures. L’expérience de la présente rentrée universitaire et à deux reprises entre Dakar et Tana (juillet 2005 pour auditionner 5 mémoires de DSSIC) et entre Dakar et Yaoundé (Décembre 2006 pour 1 mémoire).
Au total et sept années après le début de l’expérience, l’EBAD a délivré plusieurs centaines de parchemins à des conservateurs africains. Au cours de l’année académique 2009, l’Ecole comptait dans son registre d’inscription, 439 étudiants dont 1/3 suivait ses programmes à distance. Notre offre de formation attire et bien au-delà de notre espace habituel de recrutement comme le prouvent ces nombreux candidats originaires de Moldavie, du Liban, de Syrie et de Haïti et qui nous manifestent régulièrement leur ambition de rejoindre l’EBAD.
De 2004 à nos jours, notre institution a décidé de basculer progressivement dans la réforme de Bologne après l’option stratégique faite par les autorités rectorales en 2003. Sur le parcours de la Licence, comme sur celui du master, le LMD est entrain de prendre corps et présente entre autres avantages, celui d’approfondir les réformes initiées au cours des cinq dernières années, tant du point de vue du contenu que sous le rapport de la pertinence de l’offre de formation.
Après six années d’expérimentation de l’enseignement à distance, l’EBAD dispose d’un personnel qualifié et d’une ingénierie qu’elle est disposée à mutualiser pour mieux travailler à la réduction de la fracture numérique entre le Nord et le Sud. Grâce à l’engagement de ses responsables, doublée par une volonté politique très claire des autorités rectorales, notre institution capitalise quelques bonnes pratiques qu’il urge de mutualiser. Qu’il suffise de mentionner entre autres :
- Une pratique originale du tutorat : pour accompagner les apprenants et réduire les taux de déperdition traditionnellement enregistrés dans ce format de travail, le tutorat s’exerce à deux niveaux. A l’échelle de chaque classe virtuelle, un enseignant est affecté et en permanence aux tâches d’assistance. Il contribue ainsi à faciliter le processus d’assimilation des savoirs, en revisitant les contenus d’enseignement ou en suscitant sur les différents foras des classes virtuelles, des échanges sur des questions présentant un intérêt majeur pour compléter l’offre de formation. L’activité de ce tuteur virtuel est utilement complétée sur le terrain par celle d’une équipe d’enseignants et de professionnels aguerris pour avoir eux mêmes suivi nos programmes en ligne. A Dakar comme à Yaoundé ou à Ouagadougou, les apprenants sont effectivement encadrés et en particulier lorsqu’ils engagent la phase cruciale de conduite de leurs projets de recherche.
- L’option pour un tout distanciel adapté : si l’essentiel des activités de formation se font en ligne, nous avons imaginé des opportunités de travail en commun avec les apprenants. C’est l’objet des stages de regroupement, du stage virtuel et de l’accompagnement pédagogique conduit par les tuteurs locaux.
- Une offre de formation produite au Sud et destinée à satisfaire des besoins spécifiquement identifiés et en phase avec les réalités techniques et technologiques des pays d’origine de nos apprenants. Un tel choix présente l’avantage de mettre à la disposition des cibles un savoir faire opérationnel et directement investi dans l’administration des missions qui leur sont confiées. Au-delà de la correction de la fracture numérique, qui reste une des réalisations précises de notre dispositif de formation, l’orientation de la stratégie pédagogique met les étudiants en situation réelle et les incite à réinvestir dans l’activité quotidienne, les qualifications progressivement cumulées.
- Si pour certains l’apprentissage le long de la vie relève du slogan, l’EBAD peut dire en toute simplicité qu’elle l’a transcrit dans les faits : en 2009, un étudiant âgé de 23 ans suivait les programmes de la licence professionnelle alors que son père âgé de 57 ans finissait son master professionnel
Soucieuse de consolider puis de bonifier son savoir faire, l’EBAD s’engage présentement avec de nombreux partenaires africains et européens pour accompagner les initiatives similaires en cours de consolidation sur le continent africain. Au-delà de l’amélioration très certaine de son expertise elle espère apporter sa modeste contribution à la construction d’un espace africain de l’enseignement supérieur homogène et cohérent en valorisant dans le même temps les contenus francophones sur internet.
Ibrahima Lo, Directeur de l’EBAD
Statistiques
La mise en place du PIAF 2.0 et l'éclatement du Portail en plusieurs applications ne nous permet pas à ce jour de fournir des statistiques satisfaisantes.
Comment adhérer et contribuer ?
- par vos contributions aux différents modulesSi vous souhaitez apporter des contributions au Portail ou faire part d’informations qui vous paraissent importantes, vous pouvez remplir les formulaires dédiés à cet effet sur la page d’accueil du portail. N’hésitez pas !
- par votre aide financière (adhésion à l’ AIAF). Votre adhésion à l’Association Internationale des Archivistes Francophones permettra d’assurer la pérennité du Portail ! Pour cotiser, rendez vous au http://www.aiaf.org/adhesion.htm
- en vous inscrivant à un groupe de travail sur un thème donné dans l’espace « E-Professionnel ». Vous pouvez contacter le webmestre Caroline Becker pour prendre connaissance des travaux en cours et vous inscrire.
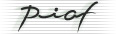 Portail international archivistique francophone - © aiaf
Portail international archivistique francophone - © aiaf
Comité de rédaction : Gérard Ermisse; Marcel Caya; Marie-Edith Brejon; Christine Martinez; Anne-Marie Bruleaux; Bruno Delmas. Publication : Caroline Becker. Maquette : Eric Ferrante


 Suivez-nous sur LinkedIn
Suivez-nous sur LinkedIn Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Facebook