6. Les matériels
Les matériels indispensables sont les caméras de prise de vue et leurs accessoires, les appareils de traitement des pellicules (développement après prise de vue ou duplication), les tables de montage équipées d'appareils de contrôle, et les lecteurs de microfilms.
Attention :
Pour l'équipement d'un atelier photographique, on peut se reporter au module 10 section 3 chap.3.2.1. (description d'un atelier photographique).
6.1. Appareils de prise de vues
Appareil de prise de vue statique
La pellicule et le document photographié sont immobiles pendant l'exposition. L'appareil se compose principalement d’un plateau de prise de vue pour poser le document, d’un système d’éclairage équilibré, incliné à 45°, en général, ampoules à filaments survoltées encore parfois mais plutôt aujourd'hui LED ou tubes à lumière du jour, d’un bloc caméra (ou tête) pourvu d’une optique, qui reçoit la pellicule 35 ou 16 mm et qui coulisse le long de la colonne porteuse graduée, afin de déterminer le champ de prise de vue et le rapport de réduction. Une cellule photo-électrique donne les indications permettant de régler l’intensité lumineuse ou la vitesse de l’obturateur (selon les modèles). S’y ajoutent des accessoires indispensables : support pour livres reliés, presse-livre constitué d’une plaque de verre épaisse sertie dans un châssis métallique afin d’assurer la planéité du document et compteur de vues. L'image produite est de bonne qualité puisqu'il n'y a pas de mouvement pendant la prise de vue. L'installation peut servir pour toutes sortes de documents délicats à filmer : volumes reliés, documents de grandes dimensions ou fragiles, journaux, etc.

Le document à microfilmer, préalablement mis en attente sur le plan de travail auxiliaire, sera placé sur le plateau de prise de vue après ouverture du presse-livre. Pour les caméras non pourvues d’origine, on peut rajouter, sous les gros registres, un berceau de type balance à deux plateaux entre lesquels s’insère le dos des registres reliés. Tout en ménageant l’intégrité du document, ce système compense en continu les différences d’épaisseur entre le côté gauche et le côté droit, en évolution constante au fur et à mesure que l’on tourne les pages. Les deux pages sont ainsi toujours ramenées au même niveau, sous la glace dont la pression assure la planéité et donc la netteté de toute l'image.
Les éclairages placés de part et d’autre, selon un angle d’incidence (environ 45°) évitant tout reflet, assurent la quantité de lumière (mesurée par la cellule photo-électrique) suffisante et nécessaire à l’obtention d’une image correctement exposée, tout en couvrant le champ de prise de vues de façon homogène, ce qui évite des différences d’exposition se traduisant en zones plus claires ou plus sombres sur le négatif.
La caméra peut monter et descendre le long de la colonne graduée en fonction du rapport de réduction recherché.
Dans l’obscurité, on introduit, dans la tête de caméra, la pellicule vierge de 30,50 mètres (100 pieds) que l’on peut couper en fonction des besoins, et on microfilme, pièce par pièce, ou deux pages par deux pages, dans le cas de documents reliés, en ouvrant le presse-livre entre chaque vue afin de tourner les pages manuellement. Le nombre de vues prises est enregistré par un compteur mécanique ou électronique. Un signal sonore prévient de l'approche de la fin de la pellicule vierge disponible.
On achève alors le transfert du film sur la bobine réceptrice, soit à l’aide d’une manivelle (Caméra MRD2) soit en commandant l’entraînement motorisé tout en préservant une longueur non exposée qui tiendra lieu d’amorce.
Appareil de prise de vue dynamique
Le document et la pellicule se déplacent de façon synchrone pendant l'exposition. L'appareil comprend un bloc caméra, un mécanisme permettant de déplacer et guider le document et un système de contrôle de l'éclairage, le tout contenu dans une chambre noire. Les documents sont introduits dans l'appareil par une fente de la chambre, dont la largeur détermine la largeur maximum du document qui pourra être reproduit. Au passage sous l'objectif le document allume et éteint automatiquement les lampes. En général ces appareils utilisent du 16 mm. Les documents à filmer doivent être de formats uniformes, en bon état de conservation et de bon contraste.
Appareil hybride
Certaines marques de caméras de microfilmage proposent divers types de systèmes hybrides permettant de jumeler ou cumuler les prises analogiques et numériques :
Soit on peut, tout en utilisant le même plateau presse-livre et la même colonne porteuse, interchanger les têtes amovibles et utiliser tantôt l’argentique, tantôt la numérique selon les besoins.
Soit le système cumule une tête argentique et un numériseur (ou scanner) ce qui permet, en une seule séance de prise de vue d’enregistrer une vue argentique sur microfilm et une vue numérique sur un disque dur.
L’intérêt étant de ne manipuler le document qu’une seule fois et donc de le préserver.
Dans ce second cas les numériseurs sont de deux types :
Type à balayage, comme un numériseur à plat : une rampe de CCD se déplace au-dessus du document le long d’un axe linéaire et enregistre l’image progressivement en plusieurs dizaines de secondes voire en plusieurs minutes, selon la résolution demandée.
Ou (comme pour les caméras à têtes amovibles et interchangeables) du type boîtier de prise de vue numérique équipé d’un objectif de haute qualité et d’un capteur à haute résolution qui enregistre la vue en un seul déclenchement et en une fraction de seconde.
6.2. Appareils de duplication et de traitement
Tireuse de duplication ou duplicatrice
On travaille en lumière inactinique pour ne pas voiler le film vierge. Le film original à copier (d’une longueur maximum d’environ 300 mètres [1000 pieds], métrage commercial des films de duplication) est placé sur l’axe débiteur supérieur droit, le film vierge sur l’axe débiteur inférieur. Les deux films se rejoignent dans le boîtier noir central dans lequel un flux de lumière traverse les vues originales et vient former une image latente sur le film vierge plaqué contre lui par une pompe à vide (selon le principe du tirage contact, c’est-à-dire sans système optique). La puissance de la lampe est préréglée par un potentiomètre gradué, en fonction des densitésoptiques mesurées sur les vues du film original. Les deux films, entraînés à la même vitesse, viennent s’enrouler autour de chacun des noyaux placés sur les axes récepteurs de gauche. Une lampe torche à lumière rouge alimentée par un cordon extensible permet de vérifier, et au besoin modifier, les réglages en cours d’opération.
Un modèle, plus perfectionné, permet de pallier le manque d’homogénéité des densités du film original : une cellule photo-électrique identifie les marques que l’on place, lors de l’analyse préalable à la duplication, aux limites des zones correspondant à un réglage prédéterminé de l’intensité lumineuse. Jusqu’à un maximum de 10 zones peuvent être préréglées à l’aide de potentiomètres dédiés numérotés de 1 à 10, par ordre de passage. Les corrections sont ainsi automatiquement effectuées en temps réel sans interrompre le défilement des films.
Il existe aussi des petits modèles qui permettent de travailler par bobines de 30 mètres.
Développeuse-sécheuse
Au premier plan à droite, le mélangeur qui l’approvisionne en produits neufs durant de traitement, derrière celui-ci, le récupérateur d’argent et, au milieu, les deux filtres d’épuration des effluents polluants.
Il serait trop long de détailler les spécificités des matériels spécialisés permettant de développer les bobines de films exposés après la prise de vue ou la duplication. Pour simplifier, le principe du traitement automatisé, sec à sec, consiste à faire passer le film en continu, à travers divers bains chimiques en cuves profondes (de préférence, pour une meilleure conservation), depuis un chargeur étanche à la lumière : révélateur qui fait apparaître les images argentiques, fixateur acide qui stoppe la montée des images et les stabilise en rendant soluble les halogénures d’argent non exposés, lavage soigneux en eau courante qui élimine les produits chimiques, en particulier l’hyposulfite du fixateur, ainsi que l’argent solubilisé, trempage dans une seconde cuve d’eau stagnante contenant en solution un agent mouillant qui accélérera le séchage et empêchera la formation de taches ou traces de coulures, séchage infra-rouge et enroulement du film autour d’un noyau. On peut récupérer immédiatement le microfilm qui est prêt à vérifier.
Complément : Importance d'un bon traitement pour une bonne conservation
La conservation des films photographiques gélatino-argentiques dépend des produits chimiques résiduels qu'ils conservent après lavage. Le traitement du master négatif argentique issu de la caméra doit être effectué conformément aux normes internationales (ISO 18 901:2002).
Les films exposés doivent être traités rapidement (sinon l’image latente évolue en devenant plus sombre) avec des bains peu usés (de vieux bains non régénérés sont moins performants et génèrent des composés chimiques nuisibles à la bonne conservation).
Un test au bleu de méthylène permet de mesurer le dosage en thiosulfate résiduel (norme ISO 18 917:1999), une teneur excessive peut produire des micro-taches et dégrader l’image. La présence de composés argentiques résiduels dus à des bains usés ou à un lavage insuffisant entraîne un noircissement de l’image à plus ou moins long terme. Un lavage suffisamment long à bonne température, en eau courante et pure, exempte de substances en suspension permet de bien éliminer tous les résidus. À la fin du traitement, le film ne doit comporter ni tache d’eau ni de produit chimique, ni poussière, impureté, rayure ou autre défaut. Jusqu’à décembre 2020 un laboratoire allemand, qui avait pris la suite de Kodak pour ce service, proposait des tests mensuels complets sur des échantillons de film expédiés par voie postale : défauts mécaniques, contrôle densitométrique et test au bleu de méthylène.
6.3. Tables de montage et accessoires de vérification
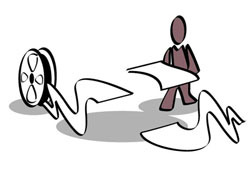
La table de montage des cinéastes – qui devient, dans le contexte qui nous intéresse, table de vérification – est l’élément indispensable au contrôle de la qualité des films. Équipée, dans l’idéal, d’un négatoscope, d’un passe-vue, d’un écran de contrôle, d’un compteur métrique (sur le principe de l'odomètre : le dos du film entraîne par frottement une pièce rotative actionnant le compteur) mécanique ou électronique. On y adjoint un densitomètre, une colleuse (ou plutôt, à plus proprement parler, une "soudeuse") à ultrasons sans oublier un compte-fil (grossissement 6 à 8x) ou même un petit microscope (grossissement 50 x) pour vérifier jusqu'au niveau du grain d'argent. Elle permet à l’opérateur de visionner les films pour vérifier la qualité des vues, de métrer les longueurs, de mesurer la densité moyenne des vues, d’effectuer des collages. Le défilement du film, manuel (manivelle) ou motorisé, doit être assez souple pour éviter des tensions qui provoqueraient des cassures.
Il subsiste encore quelques rares fabricants capables de réaliser, sur commande, des modèles variés, manuels (mus par manivelle) ou motorisés, plus ou moins équipés.

Ce modèle haut de gamme a été élaboré en concertation avec le chef d’atelier du CNMN.


les deux extrémités à assembler reposent sur un chevalet strié qui est porté à très haute température par ultra-son, une molette, elle aussi striée, mue par un chariot sur glissière, vient écraser le polyester fondu créant une soudure parfaite par interpénétration moléculaire en une seule épaisseur (comme une soudure par point entre deux tôles d’acier), à la différence d’un simple collage qui ne fait que réunir par un colloïde deux surfaces superposées ou un collage à l’acétone qui ne fait fusionner que les surfaces en contact des films en acétate.
6.4. Appareils de lecture

La lecture se fait encore à l’aide des derniers appareils analogiques (lecteurs, lecteurs-reproducteurs pourvus d’une imprimante intégrée voire lecteurs-numériseurs à lecture analogique mais à impression numérique) pourvus d’éclairage et d’un système optique (un objectif constitué de plusieurs lentilles) qui rétro-projette l’image à l’arrière d’un écran translucide intégré. Ces appareils n’étant plus produits depuis le courant de la décennie 2010, on passe désormais par un numériseur relié à un ordinateur permettant la simple lecture directe sur écran ainsi que l’enregistrement de fichiers JPEG ou TIFF ou encore les impressions sur feuille de papier A4 ou A3 via une imprimante connectée.


